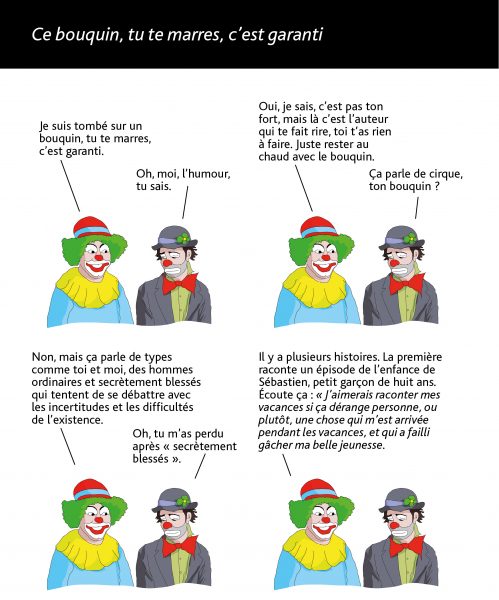
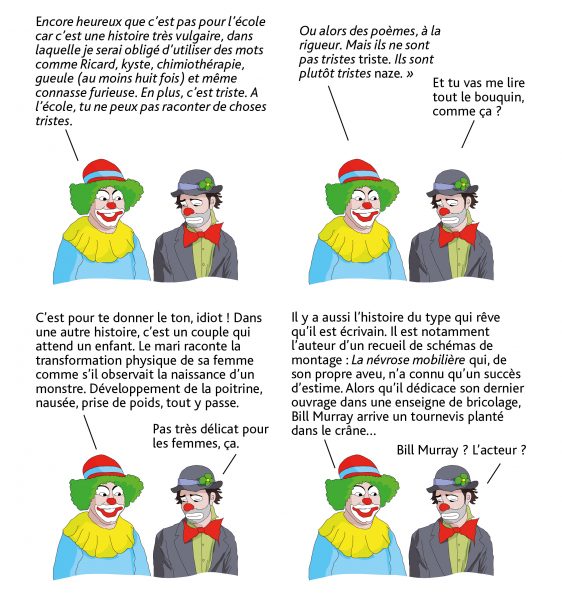
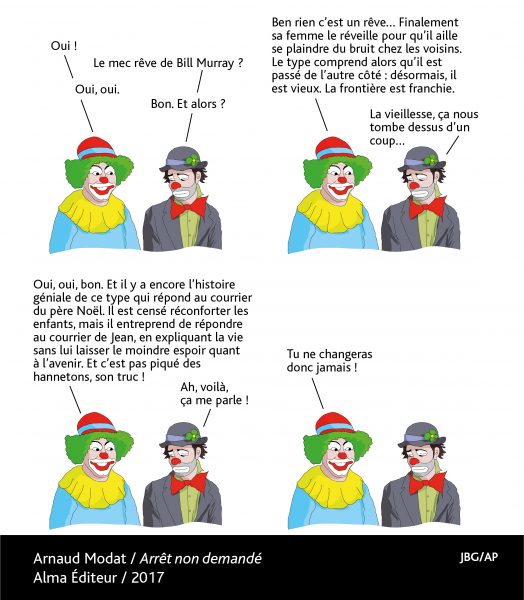
Contact et site : http://www.florianericard.com/




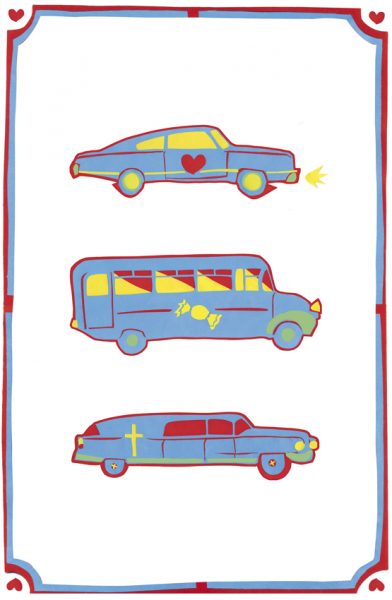
Contact : http://eliswilk.ultra-book.com/

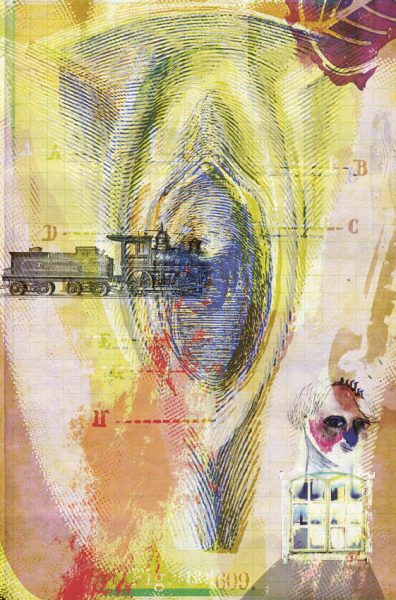






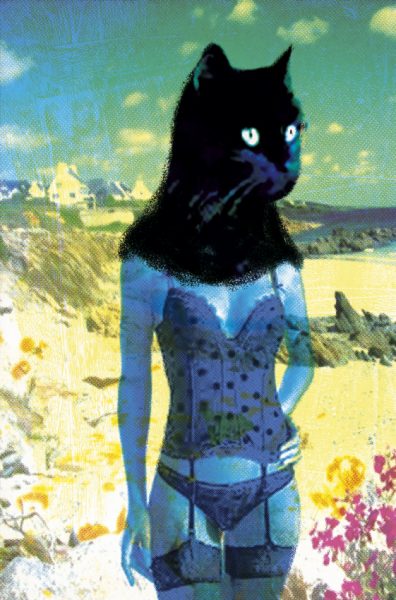

Contact : http://eliswilk.ultra-book.com/

Pour préserver mon capital littéraire déjà faible, je ferais mieux de dire que j’écris dans des hôtels. Or je n’écris que chez moi. Ce n’est pas que je sente, dans cet appartement, des vibrations propices à l’art. C’est juste que je crains de ne pas trouver ailleurs, assis sur une autre chaise et devant un autre bureau, la posture la moins inadéquate à mon dos évidemment douloureux.
Face à moi je n’ai ni la plage de Malibu ni un sommet suisse mais un mur, comme Bartleby le scribe. Sur une bande large d’un mètre qui court d’un bord à l’autre, ledit mur est sévèrement écaillé. En tombant, des lambeaux de peinture beige ont découvert la couche originelle, blanche et lépreuse (lépreux est l’adjectif réflexe en pareil cas mais je n’en vois pas de meilleur).
FRANÇOIS BÉGAUDEAU, Décapage numéro 56, février 2017.
Salut Eddie,
J’ai vu un truc à la télé sur un type qui parlait avec les morts, et qui avait l’air tranquille et sérieux, donc j’essaie, on sait jamais. Pour tout te dire, je voulais écrire à Bukowski, en fait. Mais il doit recevoir des tonnes de lettres (et je crois que déjà, de son vivant, ça le gonflait), tandis que toi, pauvre fantôme de cette chambre de motel de Los Angeles où tu as claqué le 20 mai 2003, les yeux révulsés à 48 ans, c’est sûrement pas le courrier qui te submerge. Tu dois t’ennuyer à remourir. Bref. J’ai lu tes deux romans, Encore un jour au paradis (Another day in paradise) et Du plomb dans les ailes (Steel toes), ça m’a retourné (plusieurs fois, donc je reste dans le bon sens) et je ne sais plus quoi lire maintenant. T’aurais pu attendre un peu avant de forcer la dose. Deux livres, c’est pas des masses. Toxico, voleur, criminel à 13 ans, plein de fric ou ruiné, toute la vie comme ça dans le tumulte et la déroute, des tas d’années foutues en taule, quelques-unes en cure, foutues, deux livres et c’est terminé, le cœur arrêté, une explosion molle et tu piques du nez pour toujours dans un motel pourri de Sepulveda Blvd, avec trois dollars sur la table de chevet. Maintenant, peu de gens te connaissent, encore, même aux états-Unis. Mais ça va pas durer. Deux livres, finalement, c’est pas mal. C’est ta voix, c’est toi qui restes, ta force désespérée, ton élégance, ton détachement dans le vacarme, qui restent. Ta légèreté malgré toute cette douleur dans le corps. Bref. Je pense à toi dans un appartement du 10e à Paris, c’est quand même un peu de la magie. C’est beaucoup, deux livres. Tu resteras pas longtemps coincé dans ce motel, si tu veux mon avis, tu vas t’étendre dans le monde. Moi, pour l’instant, je descends boire une bière.
Philippe Jaenada
Dans le numéro 28, juin 2006.
La première fois je ne me souviens pas mais j’ai oublié tant de choses. Peut-être y a-t-il eu l’éblouissement, les yeux écarquillés vers la lumière. Plus sûrement l’indifférence un peu blasée de qui déjà ne s’étonne plus de rien. C’était un Disney, je suppose. Avec mon frère, celui qui s’est rayé de ma vie comme s’il n’y avait tenu qu’un rôle éphémère, avant de passer à un autre film, un autre rôle, ni plus ni moins important que le précédent. Ma grand-mère était près de moi elle aussi, et elle allait mourir quelques mois plus tard. C’était Merlin l’enchanteur mais ça n’a plus d’importance. Il ne m’en reste aucune image. Ce que je garde par contre, la seule chose qui compte, c’est la sensation confuse, mais intacte presque, de leurs présences à tous les deux.
Le premier film dont je n’ai pas tout oublié, par contre, c’est Rox et Rouky je crois. Mais bizarrement, ce dont je me souviens surtout, c’est la voix de Jean Rochefort : elle sort du haut-parleur unique du mange-disque orange que j’ai reçu pour Noël, tandis que je tourne les pages du livret au format des trente-trois tours, assis sur la moquette bleue de la chambre aux rideaux pareils, meubles en formica blanc à liserés marronnasses, fenêtre aux croisillons de bois sur le jardin et l’allée plantée de tilleuls un peu malades. De cette époque, celle de mes dix ans, je garde pour Rochefort un genre de tendresse poignante, la même que j’éprouve pour Joe Dassin que j’écoutais alors en boucle, ou pour certaines chansons (Le petit garçon de Reggiani, La Fanette de Brel, Que serais-je sans toi de Ferrat) qui n’étaient pas de mon âge et qui me submergeaient, et qui aujourd’hui me taillent en pièce et m’étranglent quand par hasard je les entends à la radio, sans que je sache trop bien pourquoi sinon qu’elles appartiennent à l’enfance, au passé, et que chez moi la nostalgie n’est jamais un regret, ni une mollesse, mais un coup de pied dans le ventre, qui me coupe en deux et m’enlève le souffle. Je crois que si aujourd’hui quelqu’un me faisait la surprise de retrouver ce disque et de me le passer sans que je m’y attende, au moment même où Rochefort prononcerait le nom de Big Mama, je m’effondrerais, me diluerais, volerais en éclat. Continuer la lecture de Rox, Rouky, Rochefort, Campan et moi… par Olivier Adam