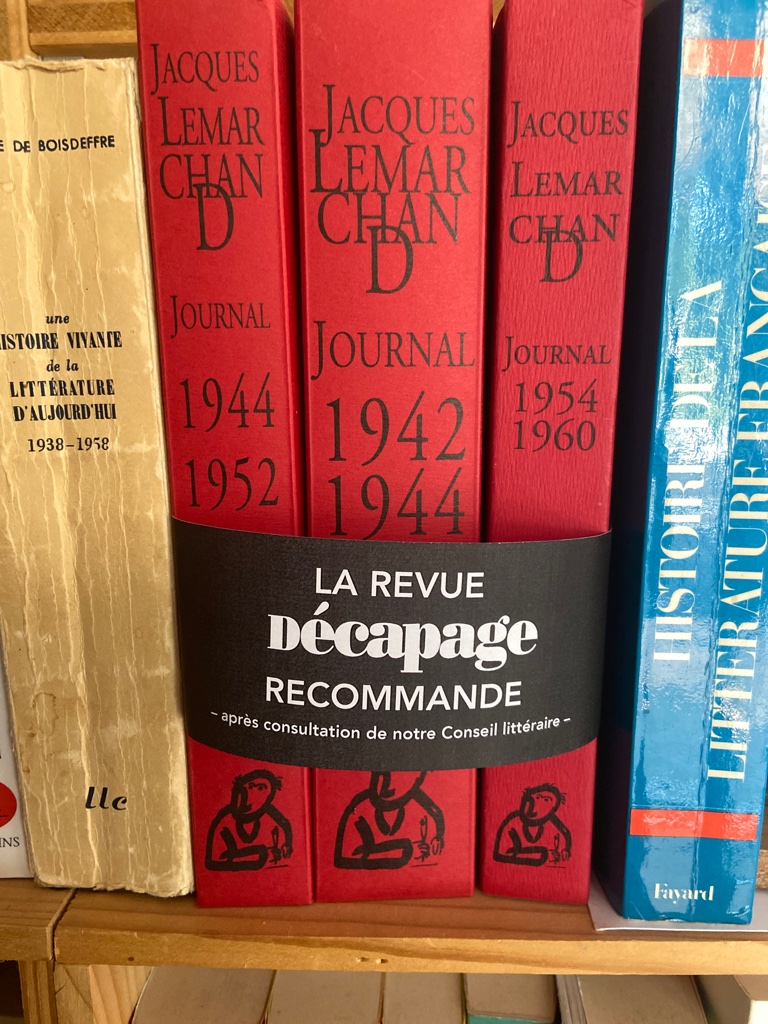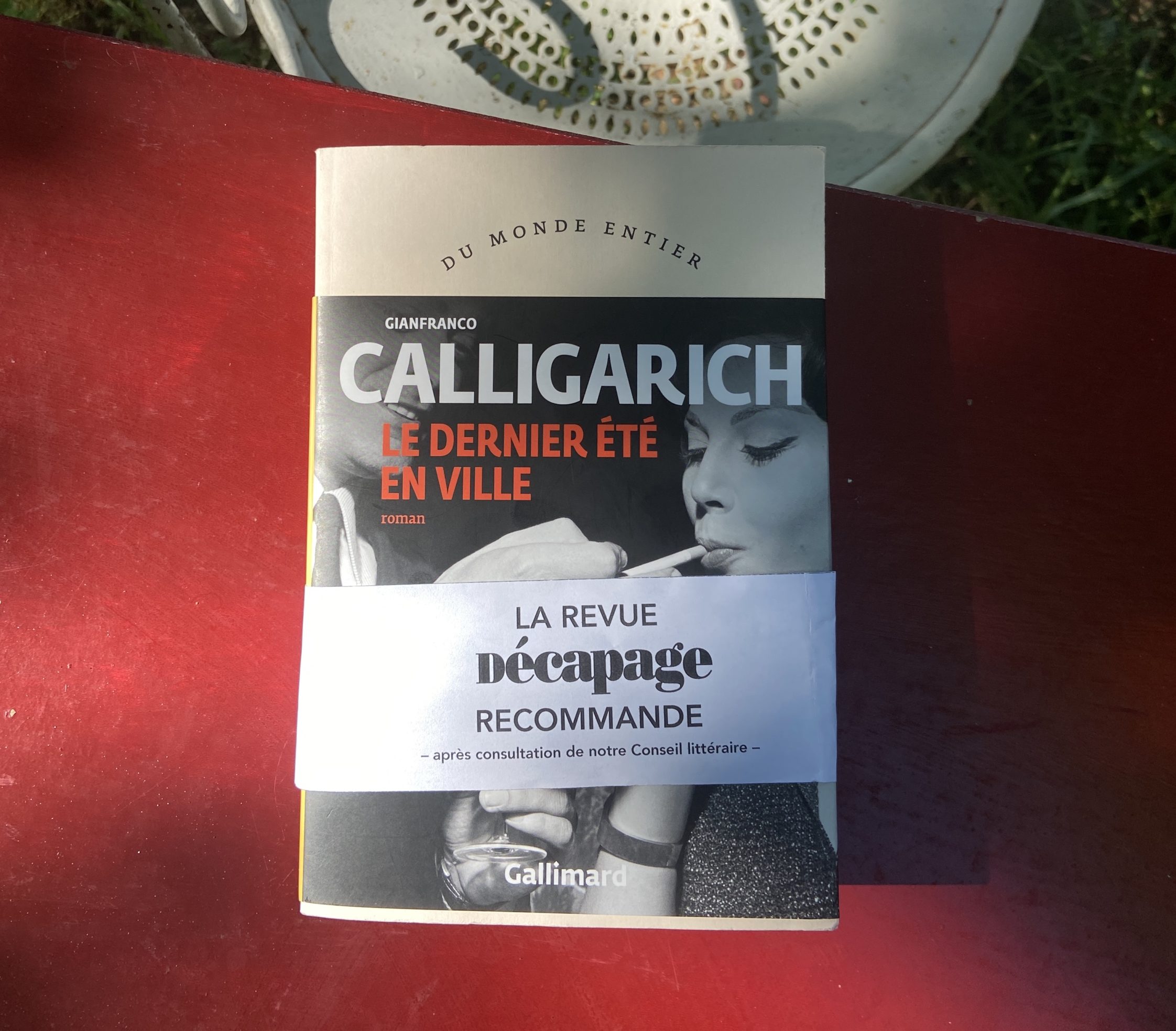On connaît la chanson : il n’y a plus de critique ; la presse ne fait plus vendre ; le critique : un écrivain raté, un type imbu de lui-même au ventre mou ; de toute façon, les critiques ne lisent pas les livres… N’en jetez plus ! Le critique littéraire est rhabillé pour l’hiver.
Arnaud Viviant dans un réjouissant Cantique de la critique (La Fabrique) revient sur ce drôle de travail qui consiste à être payé (souvent mal et peu) pour lire des livre et en rendre compte. Viviant, « généraliste de la littérature », précise : « pour décrire ma fonction, je préfère utiliser le terme de chroniqueur littéraire plutôt que celui de critique qui semble un manteau trop grand pour moi. »
La critique, qu’est-ce que c’est ? Réponse de l’auteur : « la critique est l’écriture d’une lecture. » Et Viviant rappelle une chose simple : « il n’y a pas qu’une seule lecture. » « La lecture d’un critique, quel que soit son talent, est une proposition qui ne peut se suffire à elle-même et qui en attend d’autres. » A savoir : celle du lecteur qui aura lu la critique puis, avec un peu de chance, qui lira le livre dont il était question.
Dans ce bref essai Arnaud Viviant revient sur le rôle et le sens de la critique (littéraire). Il brocarde « l’avis des consommateurs » qui s’impose, alors que le « jugement » du critique s’amenuise peu à peu. La véritable critique, nous dit-il, est « l’écriture de l’aventure d’une lecture. » Avec qui a-t-on envie de partir en voyage ? Celui qui connaît les bons chemins qu’emprunte la littérature, ou avec celui qui prend les voies tracées, bien goudronnées sans relief, ni nids-de-poule ? On a notre petite idée.
C’est plaisant, ironique, taquin. On a les mêmes lectures que Viviant – ainsi on croise Sainte-Beuve, Thibaudet, Brenner, Nadeau, Paulhan, Barthes – on s’étonne au passage de ne pas trouver Léautaud – on aperçoit aussi Maurice Pons – que nous ne n’avons pas oublié – et André Blanchard. On est presque en famille.
On se délecte des nombreuses citations et des anecdotes – surtout si on aime les citations et les anecdotes. Derrière ces lignes, parfois irrévérencieuses, on sent la passion de la littérature, le goût du partage, et la tristesse aussi peut-être de voir l’édition – et la littérature – sombrer de plus en plus dans le commercial. Viviant pose la question : « On peut critiquer un art. Mais critiquer une industrie ? » Vous avez 2 h 17 min pour y répondre.