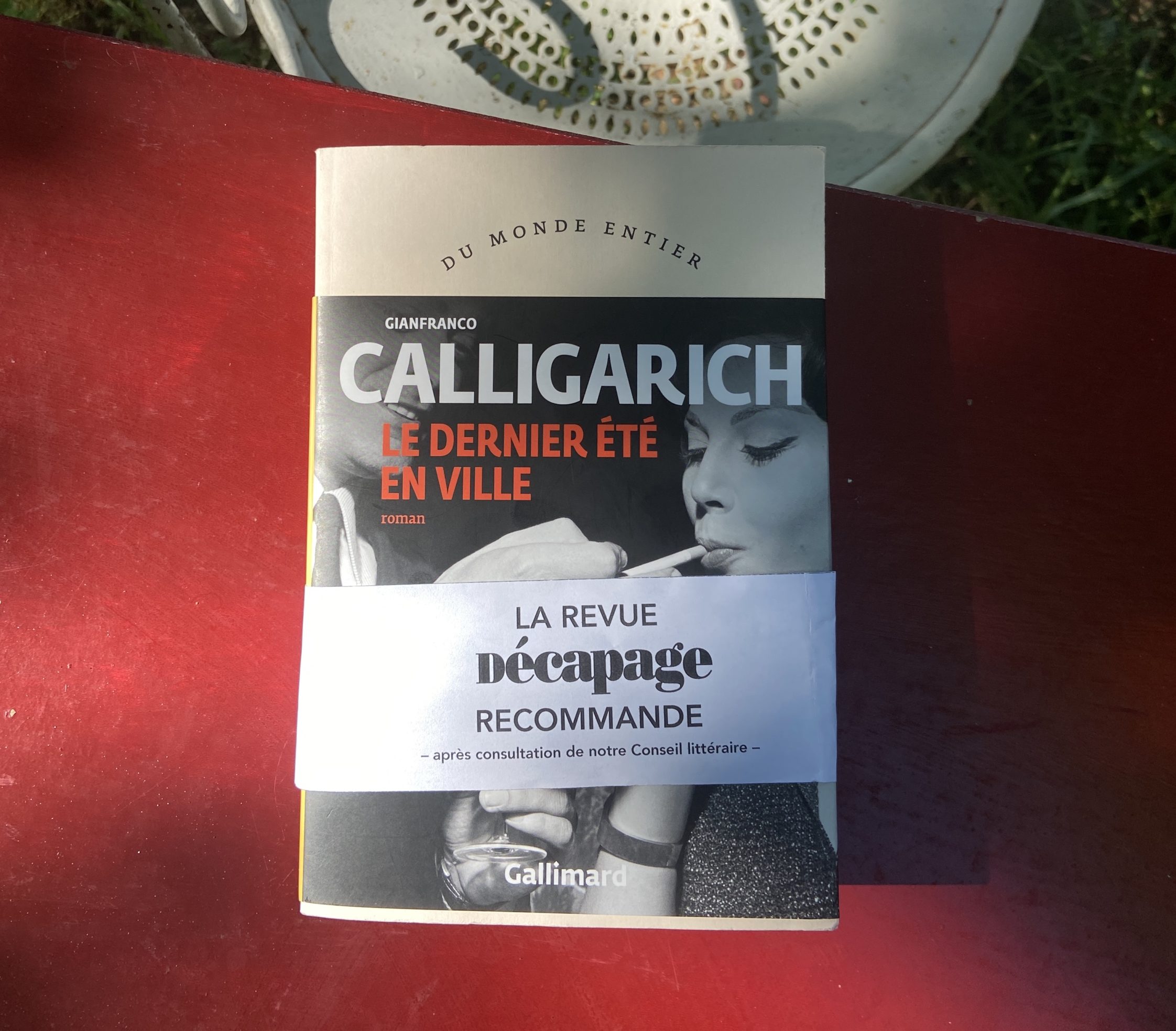Quand on cherche à se procurer une arme, il y a une chance pour que ça finisse mal. Vasco ne nous contrariera pas : « J’ai su que cette histoire allait trop loin quand je suis entré dans une armurerie » confie-t-il au narrateur dès la première phrase de « Mon maître et mon vainqueur », le nouveau roman de François-Henri Désérable (Gallimard).
Deux pages plus loin, le narrateur se retrouve dans le bureau d’un juge qui cherche le fin mot de « cette histoire ». Quelle histoire ? Celle de Vasco (Vincent Ascot) et Tina (Albertine de son prénom complet) qui se sont rencontrés lors d’une soirée chez le narrateur. Entre Vasco et Tina naît une passion aussi incandescente que l’écriture de Désérable.
Mais il y a un hic : Tina a un mari qui se trouve aussi être le père de ses enfants (ils ont même le projet de se marier dans le Luberon, à Beaumont-de-Pertuis).
Est-ce pour ça que Vasco entre dans une armurerie ? Fin du suspense : oui.
Edgar Barzac, le mari, lui a gentiment écrit dans un mail : « Je vais te défoncer à coups de batte. » (Sympa de prévenir). Vasco cherchait alors à se protéger.
Et le juge qui en sait toujours moins que le lecteur voudrait comprendre : d’où vient le revolver de Vasco et qu’est-ce que ce « cahier noirci d’une vingtaine de poèmes » ? Coup de feu et poésie, voilà un combo détonnant. C’est le lecteur qui se frotte les mains.
Jour de chance pour le juge : le narrateur est le meilleur ami de Vasco et le confident de Tina. Le cul entre deux chaises. « Autant dire qu’il attend beaucoup de moi, le juge. Et moi j’étais d’accord pour lui expliquer ce qu’il voulait, si ça lui chantait je pouvais bien me faire l’exégète d’un recueil de poèmes, mais enfin je l’avais quand même mis en garde, il allait devoir s’armer de patience, tout cela allait prendre du temps. C’était toute une histoire, cette histoire. » Le juge a le temps. Et le lecteur aussi qui assiste, dans son fauteuil ou ailleurs, à la déposition.
François-Henri Désérable est un écrivain audacieux : rien ne semble l’effrayer. Il se joue des mots et des situations les plus fantaisistes avec panache, humour et poésie. C’est aussi habile qu’intelligent, aussi drôle que facétieux, aussi sensible – telle une histoire d’amour qui finit mal – que haletant – telle une histoire d’amour qui finit mal. Sa prose fuse comme une balle tirée du pistolet de Verlaine (dont il sera aussi question). Il touche juste à chaque ligne, tire en plein cœur. Le lecteur se laisse balader avec plaisir par l’auteur, comme le juge se laisse berner sans déplaisir par le narrateur.