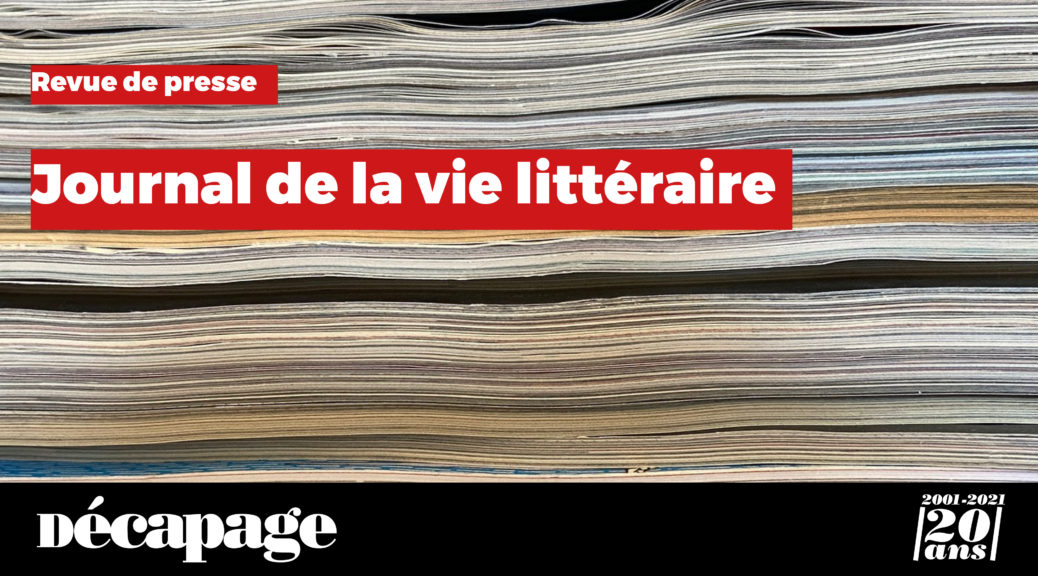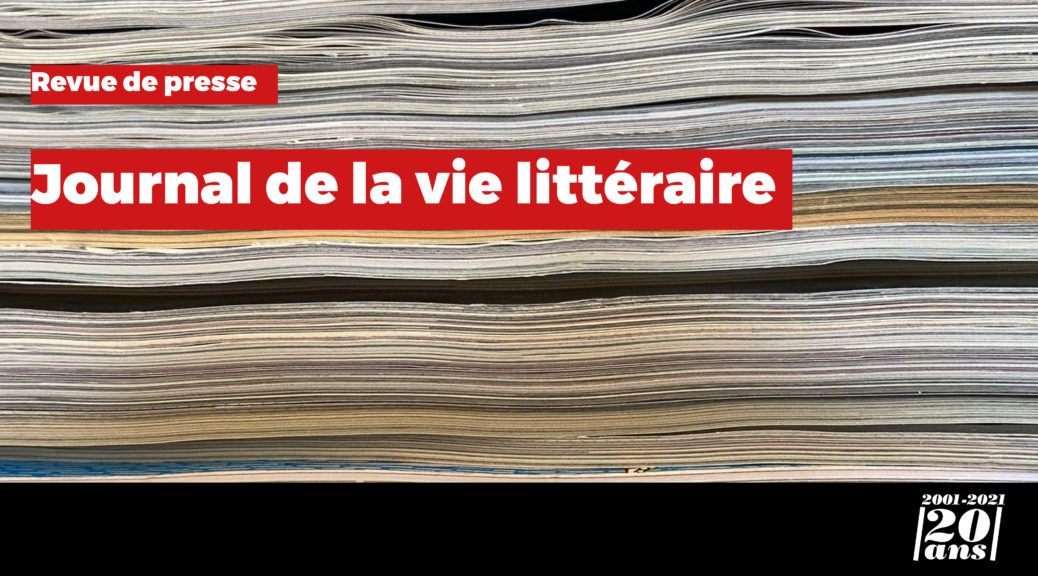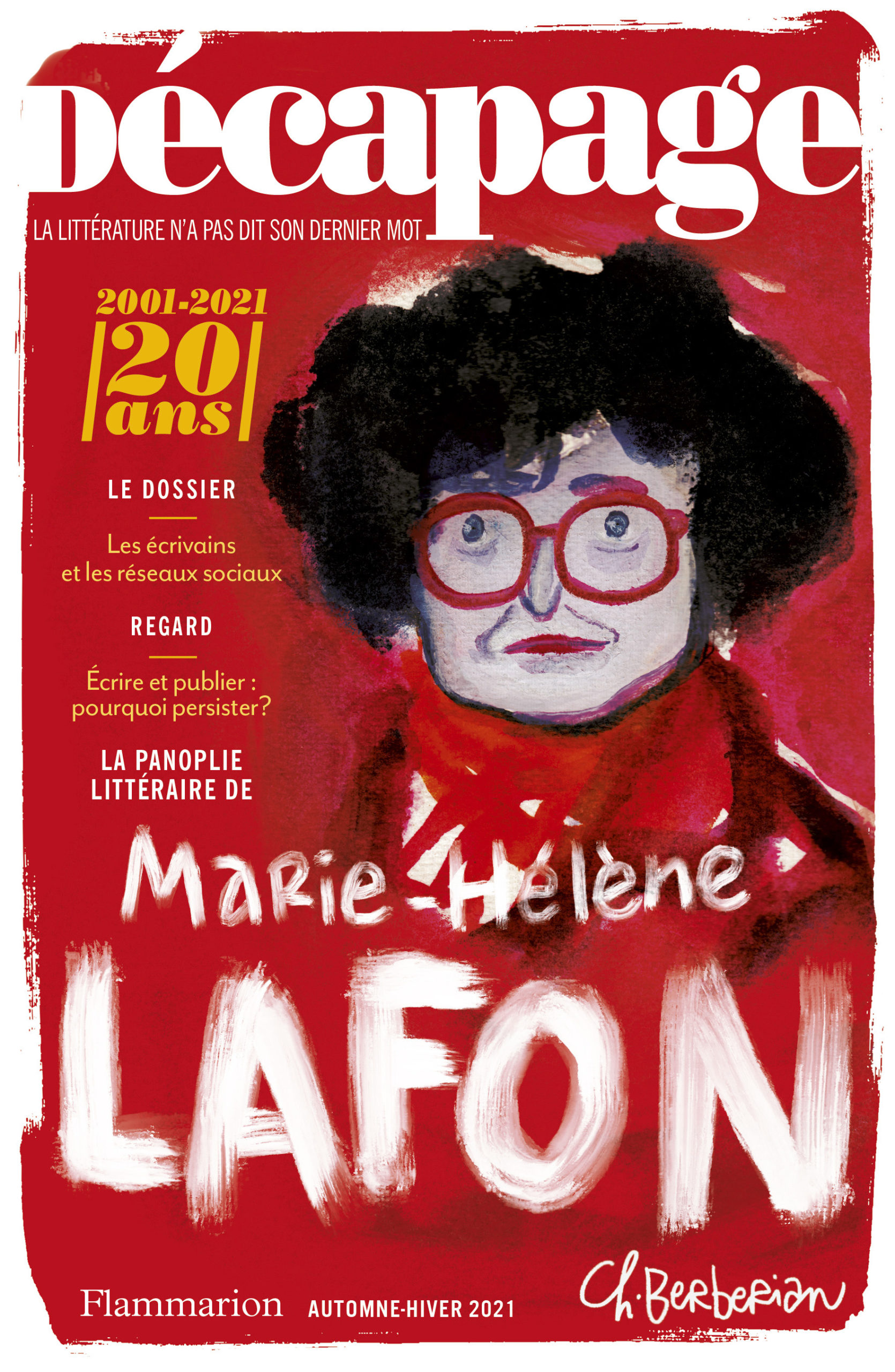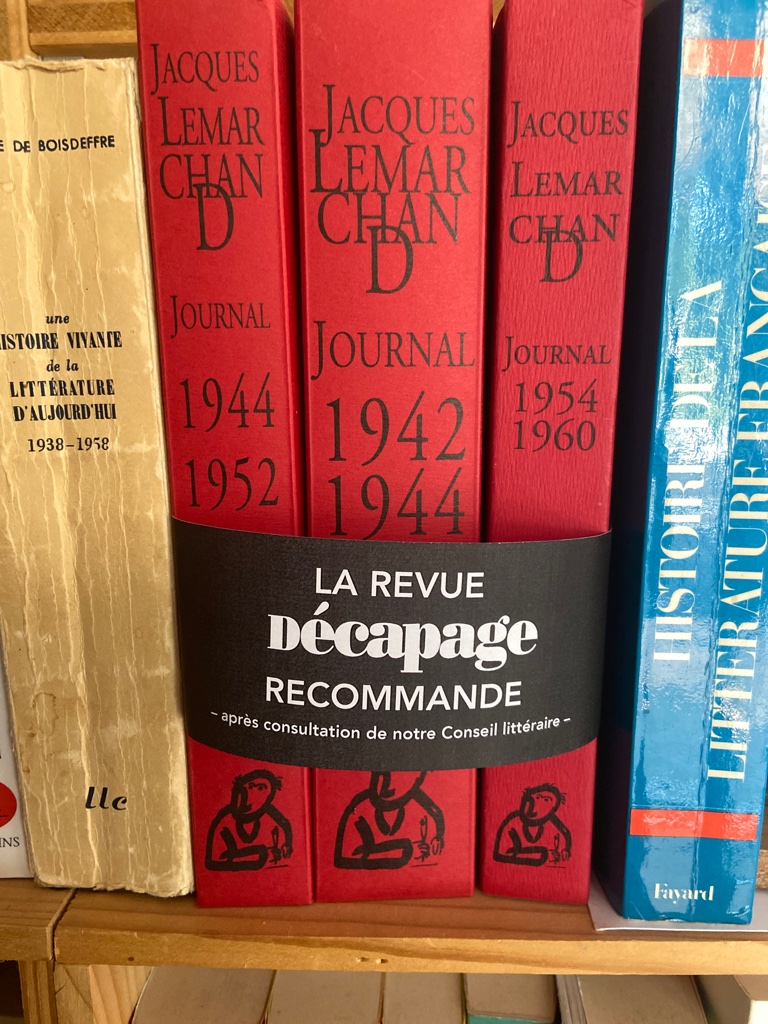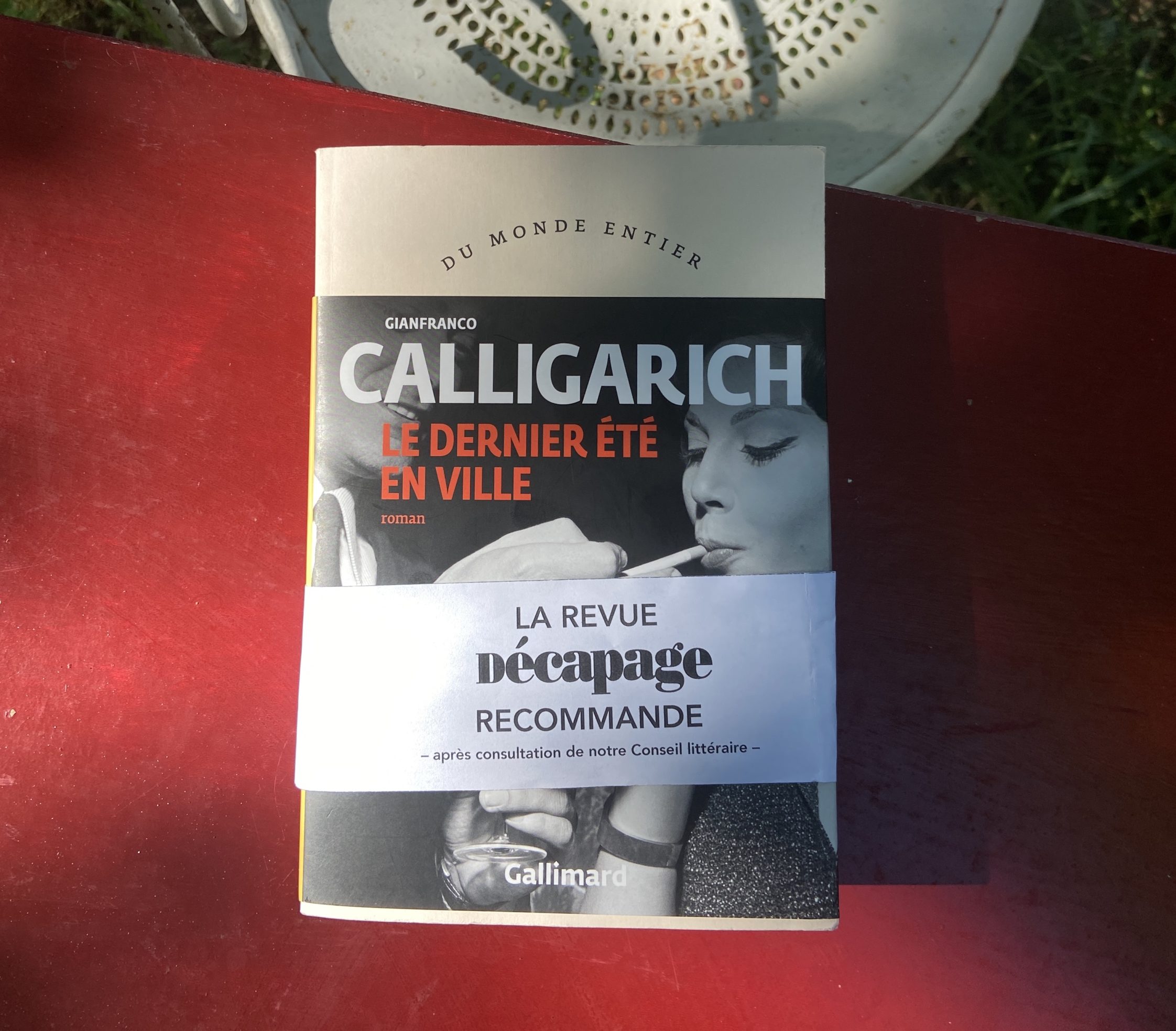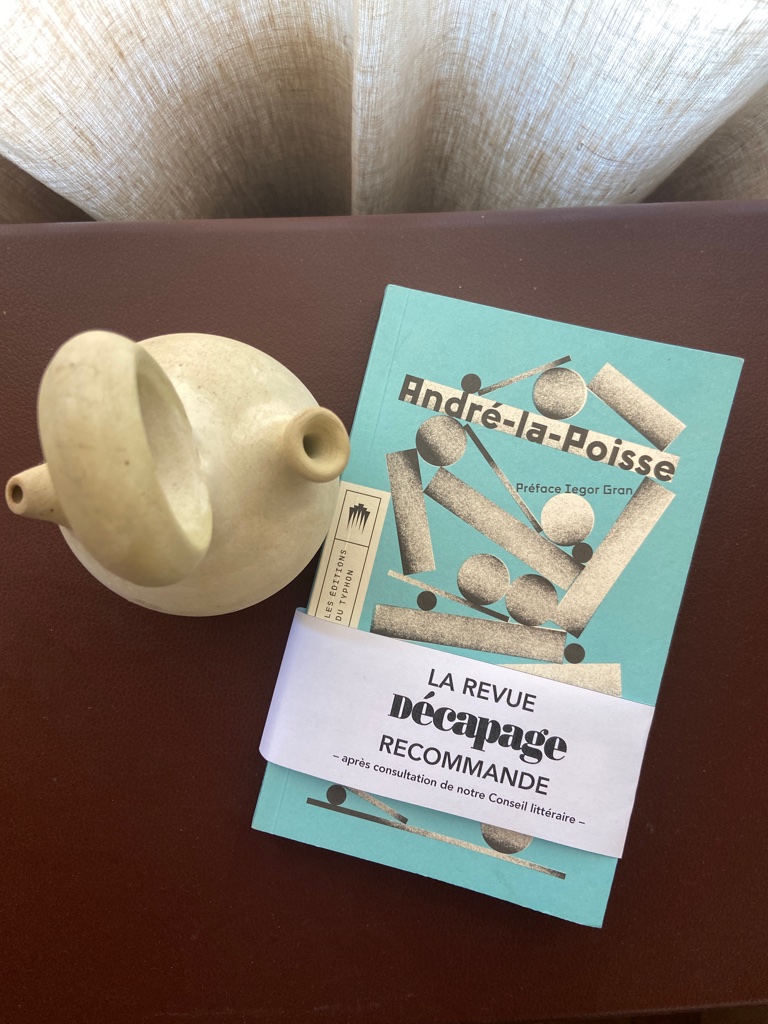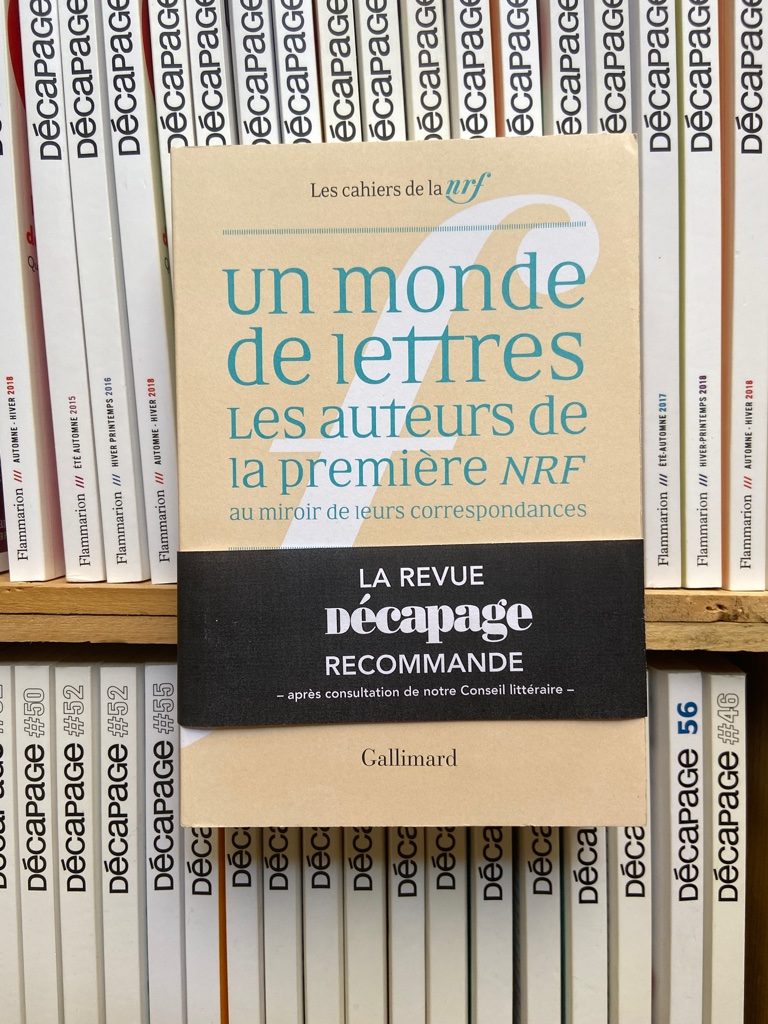Journal de la vie littéraire #4
Cette semaine, toute l’édition française était suspendue aux
listes de prix. Attente fébrile. On imagine dans quels états se trouvaient éditeurs et auteurs. Quand je vois les listes tomber, étrangement, je ne pense pas aux auteurs (et aux éditeurs) sélectionnés, mais aux absents. Ceux qu’on ne voit
pas, ceux qu’on aurait bien vus.
Liste après liste, on prend conscience qu’on ne les verra plus du tout. Ni dans les sélections, ni sur les tables des libraires. Ils disparaîtront de la rentrée. Le temps des désillusions arrive toujours plus vite que prévu. Le directeur de Stock, Manuel Carcassonne, dans un article au titre éclairant «La grande illusion de la rentrée littéraire» (La Revue des deux mondes, septembre 2021) analyse : «La rentrée littéraire est un miroir de nos péchés et de nos caprices, un accélérateur de nos faiblesses, un convertisseur de nos rares qualités en d’âpres défauts ; seuls les saints, et ils sont rares, traversent cette épreuve du feu sans perdre la tête. Certains disent : plus jamais ça ! J’en connais un, doué, qui arrêta d’écrire après avoir été recalé au Goncourt, soudain cancre.»
Goncourt.
Alors, qui trouve-t-on sur la liste ? [Cliquez ici pour
le savoir et aussi : Le Renaudot, Le Femina, le Wepler…]. Elisabeth Philippe sur le site bibliobs remarque : «Cette première sélection du Goncourt est à l’image de la rentrée littéraire : ouverte, sans nom qui domine réellement.
Bref, tout est possible.» Vraiment? On a l’impression quand même de retrouver les mêmes noms qu’ailleurs (et toujours les mêmes, sans grande surprise).
Pour Le Figaro, Mohammed Aïssaoui s’enthousiasme : «Le jury a prêté attention à des petites maisons telles que Mialet-Barrault qui fête ses deux ans !» (Il vise Philippe Jaenada et son formidable Au Printemps des monstres) Rappelons quand même que Betty Mialet et Bernard Barrault sont dans l’édition depuis les années 70. Les éditeurs expliquent sur leur site : la création en 2020 en plein confinement d’une maison est « surtout le prolongement d’une longue aventure ».
Angot
«Le seul nom de Christine Angot risque, comme toujours, de faire grincer quelques dents.» souligne Elisabeth Philippe. Pourtant, pour le moment, on a l’impression que le livre fait
l’unanimité. Petit tour d’horizon :
« Prenant le risque de s’enfermer dans un sujet unique, [Christine Angot] poursuit le puzzle débuté il y a vingt-cinq ans » constate Laëtitia Favro dans Lire-Magazine Littéraire (N°499) Valérie Marin La Meslée dans Le Point (n°2559) ne dira pas le
contraire « Alors oui, c’est sûr, on entendra que dans son nouveau roman Christine Angot ne dit rien de nouveau. » Mais « les livres de Christine Angot révèlent chacun un nouvel angle mort. » note Camille Laurens dans sa chronique du Monde des livres (N°23842) Pourquoi changer de sujet ? « Écrire est quelque chose qu’on estime devoir faire. Devoir. « Il faut que je le fasse » : j’ai besoin de ça pour me lancer. » confie à Minh Tran Huy dans Madame Figaro (n° 23961) Christine Angot, « exceptionnelle romancière » d’après Fabienne Pascaud dans Télérama (n°3736) – elle s’y connaît. À ce jour, on ne voit toujours pas qui grincent des dents.
Le roman, que vaut-il ?
Un « texte déchirant », « très tonique, libérateur » pour Claire Devarrieux dans Libération (n° 12501) Vous aimez les adjectifs ? en voilà d’autres : « étouffant, saisissant, impressionnant » pour Marianne Payot dans L’Express (n°3659) « Un texte d’une puissance inouïe sur le silence et l’inaction, la collaboration tacite. Un livre important. » pour Nelly Nelly Kaprièlian et Les Inrocks (maintenant mensuel, n°3) Pierre de Gasquet – dans Les Echos (n°23532) – s’intéresse au style : « Comme chez Marguerite Duras, le dialogue écrit envahit ses livres comme un remède aux insuffisances du récit. Mais il y a aussi une observation scrupuleuse, souvent poétique, des situations et des décors. » Il partage l’analyse de ses consœurs : « Dire qu’elle ressasse son traumatisme relève du truisme. Comment ne pas ressasser une tragédie ? La force de son écriture réside dans cet art de la dissection. » Dans L’Obs (n°2965) Elisabeth Philippe
écrivait à la fin de l’été : « Comme si tout ce qu’elle avait écrit jusqu’à présent, avec éclats, avec fracas, échouant parfois tapageusement, se trouvait ici rassemblé et unifié. Peut-être
qu’enfin les lecteurs vont comprendre non pas comment Christine Angot est devenue folle, mais pourquoi elle est devenue écrivain. » (Nous retombons dans nos thèmes de prédilection !) « Lire Le Voyage dans l’Est, c’est avoir une idée de ce qu’est la douleur, et la littérature. » conclut pour nous Olivia de Lamberterie (Elle, n°3949).
Critiquer la littérature
Mais peut-on avoir une idée de ce qu’est la littérature ? La question ne finit jamais d’animer les débats. On n’aura
sans doute pas la même définition de la littérature selon qu’on est auteur, éditeur, libraire, simple lecteur ou critique professionnel. Interrogé par La Revue des médias de l’Ina sur l’état de la critique, Pierre Assouline explique : « Il faut aussi savoir ce que signifie “critiquer”. » On est bien d’accord. «Ce n’est pas dire “j’aime” ou “je n’aime pas”» On est bien d’accord. «Il faut avoir une familiarité avec l’art en question, replacer l’œuvre dans le contexte du travail de l’auteur, voir dans quelle tradition elle s’inscrit, et aussi avoir une capacité d’écriture et de synthèse.» Et ce n’est pas donné à tout le monde.
C’est aussi prendre le risque de se tromper. Et sur le livre, et sur l’auteur et sur la littérature. La semaine dernière, dans Les Échos week-end, François Busnel revient justement sur «certaines erreurs de jugement.» Evoque-t-il son trop-plein d’enthousiasme ? Non : on n’est jamais assez enthousiaste quand on défend la littérature (mais qu’est-ce que la littérature, à la fin !?!) François Busnel regrette sa position sur Michel Houellebecq qu’il jugeait autrefois surestimé : «C’est une erreur que je confesse volontiers. Je me suis trompé. Je ne suis plus le même lecteur qu’il y a vingt ans. Aujourd’hui, je pense que Houellebecq est l’un de nos écrivains les plus pénétrants et les plus subversifs.»
On peut encenser un auteur qui va mal tourner et aussi ne
pas lire un auteur qui, au fil des livres, va construire une véritable œuvre qu’on aura négligé à ses débuts. On imagine aisément l’angoisse du citrique : passer à côté d’un grand livre, d’un grand auteur. Ainsi chacun se surveille, et tout le monde parle en priorité des mêmes livres – publiés chez les mêmes éditeurs.
Frédéric Beigbeder est le genre de critique à l’enthousiasme
communicatif. La semaine dernière dans sa chronique littéraire de Figaro Magazine, il écrivait : « Je tiens à remercier Abel Quentin de m’avoir permis de revenir aux fondamentaux du
métier de critique littéraire : admirer. » Beigbeder, toujours à
l’affût des tendances, analyse : « Il existe désormais une école de romanciers néobalzaciens, disciples de Houellebecq, qui décrivent la déliquescence française avec un sarcasme vengeur. »
Abel Quentin est l’auteur d’un deuxième roman Le Voyant d’Etampes (Édition de L’Observatoire), qui se place, lui aussi, sur plusieurs listes de Prix. Dans Le Point Michel Zink – de l’Académie française, s’il vous plaît – nous dit que « Le roman est excellent. Il est amusant, glaçant et instructif. »
Louis-Henri de La Rochefoucauld partage sans doute cet avis. On peut lire dans L’Express : c’est un roman «ultracontemporain» qui permet à son auteur d’«ausculter les cancers de l’époque.» La Rochefoucauld pose, noir sur blanc, la question qui nous brûle les synapses en riant à chaque page de ce roman : «Un livre d’anar de droite ?»
Le critique de L’Express nous donne la réponse, ouf : « Pas
du tout, et c’est là tout le talent de Quentin : se servir du roman pour mettre en scène les idées les plus variées sans se prononcer lui-même. Impossible de savoir ce qu’il pense. » L’auteur n’est pas le narrateur, rappelons-le. Le romancier sait rester secret et ne pas dévoiler le fond de sa pensée.
Le jeune Mohamed MBougar-Sarr qui met en scène un écrivain dans son roman – très remarqué aussi par les jurés (à juste titre) – La plus secrète mémoire des hommes (Philippe
Rey) –, ne nous contrarierait sans doute pas.
Extrait :
« – Je parie que tu es écrivain. Ou apprenti écrivain. Ne t’étonne pas : j’ai appris à reconnaître les gens de ton espèce au premier coup d’œil. Ils regardent les choses comme s’il y avait derrière chacune d’elles un profond secret. Ils voient un sexe de femme et le contemplent comme s’il renfermait la clef de leur mystère. Ils esthétisent. Mais une chatte n’est qu’une chatte. Il n’y a pas à
baver votre lyrisme ou votre mystique en y noyant vos yeux. On ne peut pas vivre l’instant et l’écrire en même temps.
– Bien sûr que si. On peut. C’est ça, vivre en écrivain. Faire de tout moment de la vie un moment
d’écriture. Tout voir avec les yeux d’un écrivain et…
– Voilà ton erreur. Voilà l’erreur de tous les types comme toi. Vous croyez que la littérature corrige la vie. Ou la complète. Ou la remplace. C’est faux. »
Nous voilà prévenus. Pourquoi écrire alors ? Si on ne
peut pas corriger la vie ?
« J’écris pour canaliser des peurs, explorer des obsessions. » révélait Jean-Baptiste Del Amo en début de semaine au Figaro. (Une piste intéressante) Il prévenait aussi : « J’essaye de ne jamais penser au lecteur quand j’écris, car c’est paralysant. Dans un premier temps, l’écriture est un mouvement égoïste. […]
Dans un second temps, vient le partage. Arrivé à la fin, inévitablement, je me demande comment sera reçu le livre. » Bien donc, puisqu’il a reçu le prix Fnac.
“J’écris!”
Loin des Prix littéraires – encore que… – dans L’Obs, cette semaine, Alain Mabanckou (écrivain et éditeur) raconte qu’il est allé au Café de Flore avec Charles Dantzig (éditeur et écrivain). Mabanckou préfère les cafés du 18e arrondissement, mais ce n’est pas lui qui a choisi le lieu du rendez-vous. Quand deux auteurs se rencontrent, ils parlent littérature. On le sait bien, quand on est passionné, on s’emporte, la voix monte : « La littérature française du continent noir n’aborde pas la question de la “bourgeoisie africaine” ! » s’enthousiasme Mabanckou. On imagine la conversation passionnante, on regrette de ne pas être assis à la table d’à côté. Soudain, un coup résonne dans le café grouillant de vie. Les deux auteurs sursautent : « C’est notre voisine. Elle se tourne vers nous et hurle de toutes ses forces : “Silence !!! J’écris !!!” »
La table d’à côté était donc prise, aucun regret.
Livre-Monde
Revenons, pour finir, à Mohamed MBougar-Sarr (raté pour ma « capacité de synthèse »). Les sélections pour les prix pleuvent sur ce « livre-monde, qui nous entraîne à Paris, Dakar, Amsterdam et Buenos Aires, où l’on traverse les apocalypses du XXe siècle comme on croise Borges, Sábato et Gombrowicz » (dixit Télérama n° 3736, sous la plume de Youness Bousenna. «Un joyau de savoir-faire qui vous enchante, vous transporte et vous poursuit » prévient Marianne Payot dans L’Express (n° 3660). Pour Oriane Jeancourt Galignani dans Transfuge (n°150) Mbougar Sarr glisse son stylo dans l’encrier de Nabokov : « l’auteur affectionne un même ton ironique et réflexif, joueur et poétique, pour feindre de nous mener vers une réalité qui toujours échappe. »
Si on en croit Laëtitia Favro, dans Lire, « Son inventivité, son audace et l’intransigeance de sa langue font de ce livre, qui confronte les nécessités de vivre et d’écrire, une déclaration d’amour à la littérature propre à réenchanter une rentrée un brin
austère. »
Austère, la rentrée ? Pourtant, cette rentrée nous paraissait tout sauf austère. Je tiens justement une liste de livres drôles et iconoclastes. Malheureusement, nos amis les journalistes n’en ont pas encore parlé : vivement la semaine prochaine.