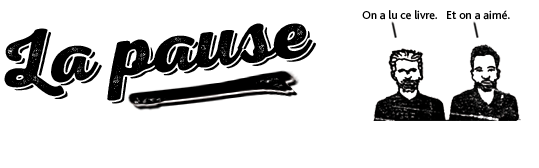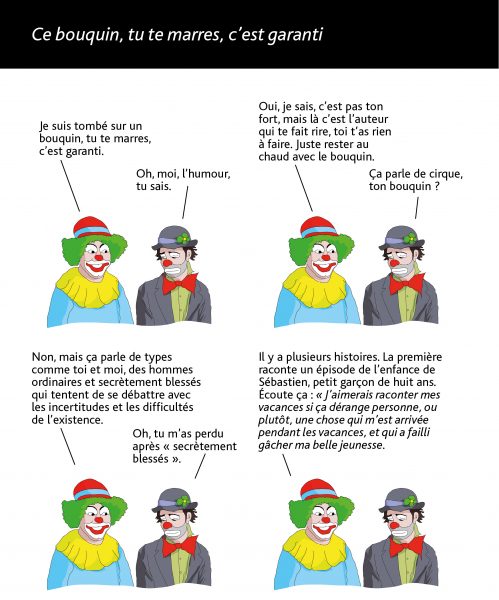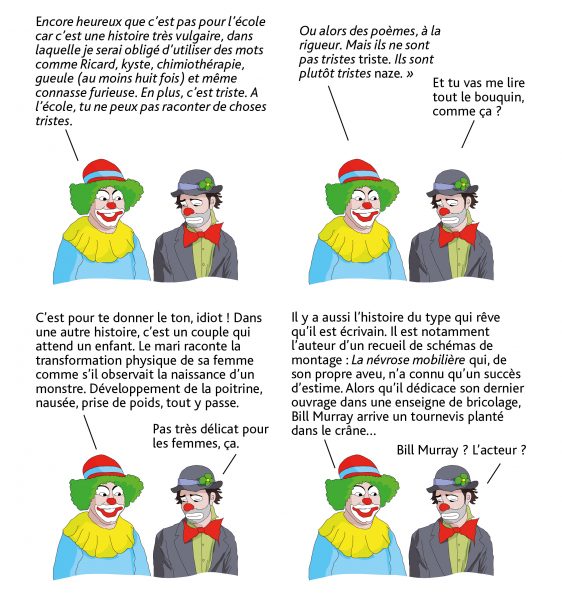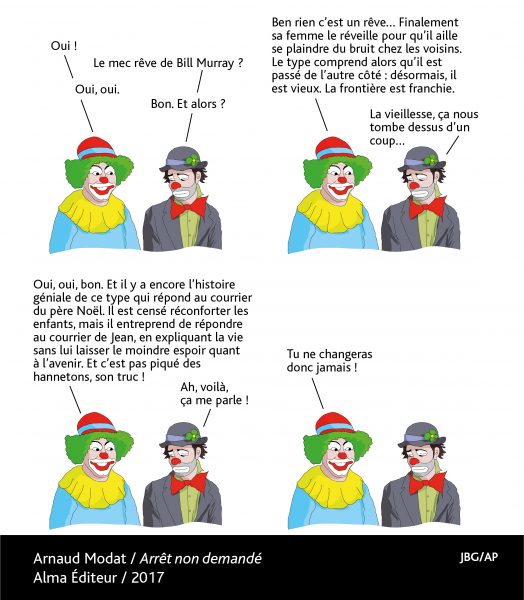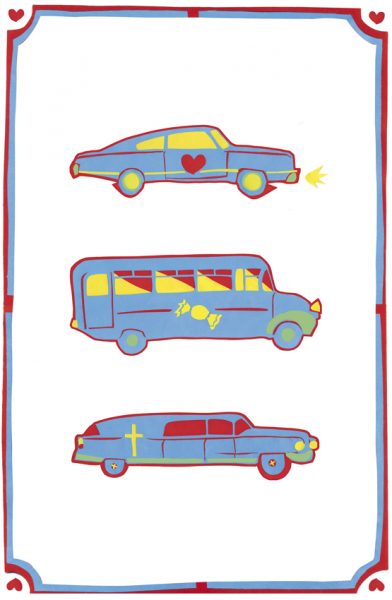Nous avons réuni trois maîtres de la littérature dans une pièce seulement éclairée d’une large cheminée. Et, tout en sirotant des tisanes, nous avons très librement commenté l’actualité culturelle et littéraire (et même assez brièvement politique)*.
*Toutes les réponses sont tirées des correspondances des auteurs
Pour commencer, Messieurs, une question simple : comment vous sentez-vous?
Flaubert – Ma santé serait bonne si je pouvais dormir. J’ai maintenant des insomnies persistantes ; que je me couche tard ou de bonne heure, je ne puis plus m’endormir qu’à 5 heures du matin. Aussi ai-je mal à la tête tout l’après-midi.
Maupassant – J’ai, comme beaucoup d’hommes de lettres, des accidents de névralgie terribles au cerveau, et je traverse en ce moment une crise aiguë, de sorte que je suis obligé de prendre cet odieux remède qu’on appelle le salycilate de soude et cela me rend idiot.
Zola – J’ai un gros rhume.
Monsieur Zola vous avez rencontré Maupassant chez Flaubert…
Zola – Je le revois encore, tout jeune, avec ses yeux clairs et rieurs, se taisant, d’un air de modestie filiale, devant le maître. Il nous écoutait pendant l’après-midi entière, risquait à peine un mot de loin en loin. L’idée ne nous venait pas qu’il pût avoir un jour du talent.
Et pourtant dès le premier livre, Boule-de-suif, on parle d’une grande oeuvre.
Flaubert – Un vrai chef-d’oeuvre, ni plus ni moins, et qui vous reste dans la tête. C’est bien original de conception, entièrement bien compris et d’un excellent style. Le paysage et les personnages se voient et la psychologie est forte.
Voilà qui doit faire plaisir à entendre, non?
Maupassant – Je reçois du reste beaucoup de compliments des gens dont l’avis m’est précieux.
Monsieur de Maupassant, cet été on vous a vu sur les plages corses avec une jeune auteur de « fanfiction », peut-on savoir ce que vous vous êtes dit?
Maupassant – Elle m’a parlé d’amour vrai, de tendresses du coeur… Elle devient tout à fait élégiaque et sentimentale ; elle a ce qu’on pourrait appeler un ramollissement du con.
Des rumeurs disent que vous n’êtes pas insensible à ses charmes…
Maupassant – Généralement, quand de pareilles inventions germent dans la cervelle de quelque portière tentée, on trouve au moins l’oeuf dont est née la calomnie. Mais j’ai beau chercher, je ne découvre même point ce qui a pu servir de prétexte à cette stupide fable. Je ne puis trouver un nom qui me mette sur la voie de l’homme ou de la femme d’imagination d’où est venu ce potin étonnant.
Dans quelques mois, il y a une échéance politique importante, que peut-on espérer pour 2017 ?
Zola – Que la France cesse enfin de se laisser dévorer par l’ambition d’une poignée de politiciens, pour s’occuper de la santé et de la richesse de ses enfants.
Vous pensez que les politiques fuient leurs responsabilités…
Zola – C’était dans l’ordre, ces gens au pouvoir nous dédaignent, mais pas autant que nous les méprisons.
Maupassant – Plus on est haut, plus on est (ou devient) imbécile. Est-ce pas abominable de vivre sous la domination de ces brutes, de dépendre de leurs caprices, de recevoir leurs injures et de toujours courber la tête. S’il n’y avait pas des gens que cela ferait souffrir, il y aurait de quoi se foutre à l’eau avec une pierre au cou. Les forçats sont moins malheureux.
Vous soutenez donc la colère des auteurs qui souhaitent défendre le droit d’auteur et la création?
Maupassant – On fait en ce moment un grand travail sur les pensions des hommes de lettres. La plupart de ces pensions étaient attribuées à des femmes ou à des hommes qui n’avaient rien de commun avec les lettres. On veut que désormais elles soient uniquement réservées aux littérateurs de sorte qu’on est en train de rayer beaucoup de personnes qui n’avaient aucun droit pour en recevoir. Aussitôt que ce travail sera terminé, on s’occupera de faire une nouvelle répartition uniquement aux hommes de lettres.
La condition matérielle des auteurs est de plus en plus préoccupante, non?
Zola – Un livre ne nourrit jamais son auteur.
Flaubert – Le succès matériel doit être le résultat, jamais un but. Autrement, on perd la boule, on n’a même plus le sens pratique. Faisons bien, puis advienne que pourra ! Ah ! ah ! moi aussi j’ai des principes. J’en ai même trop pour mon bonheur.
Revenons, si vous le voulez bien, un instant à l’actualité littéraire. On annonce 363 romans français pour cette rentrée. C’est encourageant, non?
Flaubert – Ce qui me fait enrager, maintenant que je voudrais ne pas perdre une minute, c’est le temps perdu à lire les romans des jeunes ! Trop d’hommages !
On dit beaucoup de bien du livre de Karine Tuil [livre paru en septembre 2016, ndlr].
Maupassant – C’est une bluette, mais ce n’est point une étude. C’est adroit, mais ce n’est pas fort.
Vous avez lu le dernier livre de Laurent Mauvignier?
Maupassant – Je l’ai lu le jour même où il m’est parvenu, et je vous dois une sensation charmante analogue à celle qu’on éprouve quand on sort de bonne heure par les tièdes matins, tout remplis de senteurs d’herbe et de fleurs. Voilà de la poésie claire et parfaite de forme, et attendrie, et vibrante, comme on n’en lit pas souvent.
Flaubert – Au commencement, je me suis révolté contre certaines afféteries et négligences de style. Puis je me suis laissé empoigner et, en somme, je trouve ce livre plein de talent. Telle est mon opinion sincère.
Un commentaire, peut-être, sur le classement des meilleures ventes de livres de cette semaine?
Flaubert – Je m’étonne toujours de ces enthousiasmes pour des génies de quinzième ordre.
D’après une étude américaine, si l’on consacre trente minutes par jour à la lecture, on augmente son espérance de vie de 23 % sur douze ans. Ça vous inspire quoi?
Flaubert – Je tombe sur les bottes, à force de lire des stupidités !
[Notre téléphone sonne. Un sms nous annonce la naissance du premier enfant de la chroniqueuse qui était enceinte (voir, histoire d’ours numéro 54). On s’excuse.]
Flaubert – J’adore les enfants, et étais né pour être un excellent papa. Mais le sort et la littérature en ont décidé autrement !…. C’est une des mélancolies de ma vieillesse que de n’avoir pas un petit être à aimer et à caresser.
Le dernier clip du rappeur Orelsan, l’un de vous l’a regardé sur YouTube ?
Maupassant – Il m’a ravi, il m’a fait rire et rêver, m’a séduit par son style, par la vérité bizarre, par la philosophie cocasse et délicieuse. Je vais, d’ailleurs, écrire ce que j’en pense.
Flaubert – Notre ami sait s’y prendre pour faire parler de lui. Rendons-lui cette justice.
Vous êtes aussi des hommes de théâtre, avez-vous vu l’une des pièces de Florian Zeller, en ce moment l’auteur français le plus joué dans le monde ?
Flaubert – Hier soir j’ai vu L’Autre, et j’ai pleuré à diverses reprises. ça m’a fait du bien. Voilà ! Comme c’est tendre et exaltant ! Quelle jolie oeuvre, et comme on aime l’auteur !
Ah, vous le connaissez ?
Zola – Nous avons dîné deux fois, la première chez Adolphe, qui nous a empoisonnés, la seconde place de l’Opéra-comique où nous avons mangé une bouillabaisse extraordinaire.
Comment voyez-vous le développement des blogs littéraires au détriment de la vraie critique ?
Flaubert – Mais que dites-vous du dogme de « l’hypocrisie littéraire », tellement établi maintenant qu’il n’est plus permis d’avoir une opinion à soi ? On doit trouver bien tout, ou plutôt tout ce qui est médiocre. Quand un monsieur proteste, ça révolte.
Zola – Je tiens à être lu avant d’être jugé, préférant un éreintement sincère à quelques mots complaisants.
Vous croyez encore au pouvoir des critiques ?
Flaubert – Quand on écrit bien, on a contre soi deux ennemis : 1) le public parce que le style le contraint à penser, l’oblige à un travail ; et 2) le gouvernement, parce qu’il sent en nous une force, et que le pouvoir n’aime pas un autre pouvoir.
Aujourd’hui, les écrivains n’ont plus le pouvoir, non ?
Zola – Ah ! Cette malheureuse littérature est bien malade !
Ce serait plutôt Facebook, Twitter, les réseaux sociaux qui peuvent faire et défaire les réputations. C’est là que ça se passe, non ? Il y a un an, Paulo Coelho a publié un message sur Facebook afin de défendre l’Islam, vous l’auriez fait vous ?
Flaubert – Cette prétention de défendre l’Islamisme (qui est en soi une monstruosité) m’exaspère. Je demande, au nom de l’humanité, à ce qu’on broie la Pierre-Noire, pour en jeter les cendres au vent, à ce qu’on détruise La Mecque, et que l’on souille la tombe de Mahomet. Ce serait le moyen de démoraliser le fanatisme.
Il ne faut pas confondre l’Islamisme et l’Islam, une religion pratiquée par plus d’un milliard de personnes…
Flaubert – Je demande ce qu’elle a jamais fait de bien dans le monde ?
Monsieur de Maupassant, vous ne dites rien ?
Maupassant – Je trouve mes pensées médiocres et monotones, et je suis si courbaturé d’esprit que je ne puis même les exprimer. Quant aux idées, qui sont pour beaucoup d’hommes, pour les meilleurs, la raison d’être, je trouve que les plus compliquées sont simples à faire désespérer de l’intelligence humaine, que les plus profondes quand on y a réfléchi cinq minutes, sont pitoyables.
Monsieur Zola, sur le réseau Twitter, vous n’avez pas été très tendre avec Carla Bruni.
Zola – C’est vrai, je n’aime pas beaucoup cette artiste, dont la voix se brise dans les éclats de force ; qui manque, selon moi, de foyer intérieur, de puissance. Mais elle a ce qui vaut mieux : l’originalité, la vie ; et il est très certain que lorsqu’elle reste elle-même, elle est incomparable.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune plumitif qui voudrait se lancer dans l’écriture ?
Zola – Chaque fois qu’un jeune homme de province tombe chez moi pour me demander conseil, je l’engage à se jeter en pleine bataille, dans le journalisme. Il a vingt ans, il ignore l’existence, il ignore Paris surtout : que voulez-vous qu’il fasse ? S’enfermer dans la chambre d’un faubourg, rimer des vers plagiés de quelque maître, mâcher en vain le vide de ses rêves ? Il en sortira au bout de cinq ou six années aussi ignorant de la vie, ayant encore tout à apprendre, l’intelligence malade de son inaction. Combien je le préfère dans la lutte quotidienne qui seule fait connaître les choses et les hommes ! À vingt-cinq ans, le besoin de se défendre l’aura armé, il saura, il sera mûr pour la production. On dit que la presse en vide beaucoup de ces jeunes gens : sans doute, mais elle ne vide jamais que ceux qui n’ont rien dans le ventre.
Maupassant – Il faut avoir un bon système nerveux, très sensible, un épiderme très délicat, des yeux excellents pour voir, et un bon esprit pour savourer et mépriser. Et se moquer ensuite de tout ce qu’on voit, de tout ce qui est respecté, considéré, estimé, admiré, communément, s’en moquer d’une façon naturelle et constante comme on digère ce qu’on mange.
Voyez, c’est-à-dire, avalez et rendez la vie à la façon des aliments de toute nature qui deviennent la même ordure. Tout n’est que de l’Ordure quand on a compris et digéré. Mais tout peu paraître bon quand on est gourmand. Lorsqu’on apporte à cette dégustation un esprit curieux, les premières bouchées sont souvent fines, les premiers baisers sont parfois doux. Lorsque c’est passé – blaguez.
Flaubert – Voici mon opinion : Il faut toujours écrire, quand on en a envie. Nos contemporains (pas plus que nous-mêmes) ne savent ce qui restera de nos oeuvres. Voltaire ne se doutait pas que le plus immortel de ses ouvrages était Candide. Il n’y a jamais eu de grands hommes vivants. C’est la postérité qui les fait. Donc travaillons, si le coeur nous en dit, si nous sentons que la vocation nous entraîne ; quant au succès matériel, grand ou petit, qui doit en résulter pour nous, il est impossible là-dessus de rien présager. Les plus malins (ceux qui prétendent connaître le public) sont chaque jour trompés.
Et pour vous, écrire, c’est devenu simple, non ?
Zola – L’enfantement d’un livre est pour moi une abominable torture, parce qu’il ne saurait contenter mon besoin impérieux d’universalité et de totalité.
Vous n’avez jamais pensé à écrire à quatre mains ?
Zola – Je suis un autoritaire en littérature et je crois que toute collaboration est incapable d’un chef-d’oeuvre. Au théâtre pourtant, je l’admettrais plus volontiers. Il est certain que deux tempéraments peuvent s’y compléter, la besogne s’y diversifier heureusement, l’oeuvre y bénéficier du travail commun. Des talents s’accouplent ; le génie reste solitaire.
Avez-vous des projets pour la suite?
Flaubert – Je ne sens plus le besoin d’écrire, parce que j’écrivais spécialement pour un seul être qui n’est plus. Voilà le vrai ! et cependant je continuerai à écrire. Mais le goût n’y est plus, l’entraînement est parti. Il y a si peu de gens qui aiment ce que j’aime, qui s’inquiètent de ce qui me préoccupe ! Connaissez-vous dans ce Paris, qui est si grand, une seule maison où l’on parle de littérature ? Et quand elle se trouve abordée incidemment, c’est toujours par ses côtés subalternes et extérieurs, la question de succès, de moralité, d’utilité, d’à-propos, etc. Il me semble que je deviens un fossile, un être sans rapport avec la création environnante.
Zola – Je fais mes trois petites pages par jour, ce qui est mon train-train habituel.
Maupassant – Je compte aller à Bougival la semaine prochaine.
[Et alors qu’on s’éloigne, Émile Zola nous rattrape :]
Zola – À Médan, dans ma grande salle, contre un mur, je vais faire une panoplie d’instruments de musique. Mais il me manque une pièce importante, pour le milieu et je désire vivement trouver un tambourin. Ici, mes recherches ont été vaines. Tâchez donc, à Aix ou à Marseille de me procurer ce tambourin. Je le préférerais ancien.